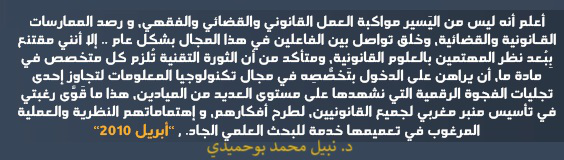Actu-Juridique : Comment vous êtes-vous intéressé à l’ADN ?
Patrice Reviron : Avant d’être avocat, j’ai été infirmier puis j’ai fait une licence en biologie. J’ai ensuite choisi de me réorienter vers le droit, tout en gardant un fort intérêt pour les sciences. J’ai fait un DU de criminalistique en parallèle de mes études de droit. L’ADN m’avait toujours passionné du point de vue scientifique. En matière forensique, je lui attribuais une très forte valeur. Jusqu’au jour de 2004 où, devenu avocat depuis peu, j’ai rencontré un dossier très emblématique qui se révélera contenir deux erreurs majeures en matière d’ADN.
AJ : Quelle était cette affaire ?
Patrice Reviron : Une mère et sa fille avaient été retrouvées mortes chez elles. Les enquêteurs avaient retrouvé un profil génétique identique sur la robe de chambre de la mère et sur un fil électrique qui avait servi à attacher la fille. Ce même profil se trouvait encore sur la porte-fenêtre par laquelle s’était enfui l’auteur des faits. On considérait qu’il s’agissait forcément de l’ADN du ou d’un des auteurs. L’enquête s’est néanmoins orientée vers un suspect qui n’était pas, de façon certaine, à l’origine de ce profil génétique, sans qu’il ne soit d’ailleurs répondu à la question de savoir d’où provenait cet ADN. Le suspect avait été condamné à trente ans de réclusion. Mais avant son procès en appel, le FNAEG a identifié le profil génétique retrouvé sur les lieux du crime. Un supplément d’information a alors été ordonné. Et là, surprise : la personne identifiée à l’aide de ce profil génétique habitait à 800 kilomètres du lieu du crime et, heureusement pour elle, n’avait jamais quitté sa région de toute sa vie. Une enquête a été menée, à l’issue de laquelle il s’est avéré que les trois échantillons sur lesquels on avait retrouvé ce profil génétique avaient été contaminés au laboratoire d’analyse. C’est ce que j’appelle un cas historique : l’erreur a été démontrée de façon absolue. L’accusé condamné en première instance a finalement été condamné en appel. De façon incroyable, il s’est ensuite trouvé mis en cause à tort à cause de l’ADN pour le meurtre d’une femme tuée chez elle à Marseille. Son profil génétique avait été retrouvé sur un verre posé sur la table de nuit de la victime. Problème : au moment des faits, cet homme était en prison. Cela ne pouvait pas être lui. On a pu démontrer que deux tubes avaient été inversés au laboratoire qui travaillait au même moment sur un scellé appartenant à cet homme et sur le dossier du meurtre à Marseille. J’ai ainsi vu, dans un même dossier, deux erreurs qui étaient alors considérées comme quasiment impossibles. C’est là que j’ai vraiment commencé à m’intéresser à l’ADN comme indice.
AJ : Ces erreurs sont-elles fréquentes ?
Patrice Reviron : Ces affaires ont servi de leçon, les procédures ont été sécurisées mais il y a toujours des erreurs. Elles peuvent se produire à tous les stades, du recueil de l’indice jusqu’au travail en laboratoire et à l’interprétation des résultats d’analyse. Les erreurs de contaminations sont vite arrivées. Il suffit qu’un enquêteur manipule un objet, même sans importance, sur lequel se trouve de l’ADN d’une personne et transporte ce profil génétique avec ses gants sur un autre objet signifiant, par exemple l’arme du crime. Cela va laisser croire aux enquêteurs que la personne a touché l’arme du crime. Il faut avoir conscience du caractère fragile de l’indice ADN.
AJ : On dit pourtant que l’ADN est la reine des preuves. Depuis quand s’est-elle imposée comme telle ?
Patrice Reviron : La technique d’identification par l’ADN a été découverte en 1985 par le généticien britannique, Alec Jeffreys. Les experts travaillaient alors sur des quantités d’ADN très conséquentes et visibles : du sperme ou du sang. Au milieu des années quatre-vingt-dix, les techniques ont fortement évolué. Il est devenu possible de caractériser des profils génétiques issus d’une quantité tellement infime de matière biologique qu’elle était invisible. On a parlé alors d’ADN « de contact », mais est-ce nécessairement le cas ? Est-il nécessaire qu’un contact direct entre une personne à l’origine de l’ADN et un objet ait eu lieu ?
AJ : Racontez-nous l’affaire Lukis Anderson, aux États-Unis…
Patrice Reviron : C’est une affaire réelle qui montre à quel point la preuve ADN est fragile. En 2012, Lukis Anderson a été mis en cause en Californie pour avoir participé à un « home jacking », un cambriolage très violent au cours duquel le propriétaire de la villa avait été tué. Quand une victime se défend, on peut parfois retrouver l’ADN de son agresseur sous ses ongles. Or l’ADN de Lukis Anderson a été retrouvé sous les ongles du propriétaire de la villa. Anderson est alors répertorié dans la base de données génétique locale, ce qui permet de l’identifier : il est placé en détention. Une avocate commise d’office est désignée. Elle enquête et découvre que Lukis Anderson, au moment des faits, était dans le coma à l’hôpital, surveillé toutes les 20 minutes. Cela ne pouvait pas être lui…
AJ : Comment son ADN était-il arrivé sous les ongles de la victime ?
Patrice Reviron : L’équipe paramédicale qui a récupéré Lukis Anderson le matin est ensuite intervenue sur la scène de crime. Dans les deux cas elle a utilisé un oxymètre de pouls, un petit objet que l’on met au bout du doigt pour évaluer les pulsations cardiaques et l’oxygénation du sang. C’est l’oxymètre qui a transféré, trois heures plus tard, l’ADN de Lukis Anderson sous les ongles de la victime, où il s’est mélangé avec celui de cet homme et de son épouse.
AJ : La France a-t-elle connu des cas similaires ?
Patrice Reviron : Oui. En Corse, lors d’une « nuit bleue », des autonomistes ont fait sauter des villas de continentaux. Ils avaient installé des bouteilles de gaz dans plusieurs villas vides. Dans une des maisons, trois bouteilles de gaz n’ont pas explosé. On a recherché des profils génétiques sur ces bouteilles de gaz et on a effectivement retrouvé un ADN sur la collerette à la base de chacune des trois bouteilles. On a caractérisé le même ADN, dans la chambre où elles se trouvaient, sur le guéridon et la lampe de chevet posée sur un lit lui-même poussé par les auteurs pour faire de la place. Tous ces objets avaient été manipulés par les auteurs pour installer les explosifs. Les enquêteurs ont constaté qu’il s’agissait d’un profil génétique féminin, chose inhabituelle pour des attentats en Corse. Surtout, ils ont très vite découvert qu’il s’agissait de l’ADN de la propriétaire des lieux, âgée de 78 ans, qui n’avait pas mis les pieds dans sa résidence secondaire depuis six mois. L’auteur des faits avait manipulé le guéridon et la lampe avec des gants et déplacé ainsi l’ADN de la propriétaire sur les trois bouteilles de gaz. Cette hypothèse était incontournable dès lors qu’il était avéré que cette dame n’avait pas mis les pieds en Corse depuis plus de six mois. Si elle avait été présente la veille dans sa maison, on aurait pu croire qu’elle avait simulé un attentat pour obtenir de l’argent de son assurance, par exemple.
AJ : Que montrent ces situations ?
Patrice Reviron : Déjà, que l’indice ADN est fragile. Mais aussi qu’on ne se pose des questions à son sujet que s’il y a une impossibilité manifeste que le profil génétique retrouvé corresponde à celui de l’auteur. Par exemple, quand le suspect est emprisonné ou à l’hôpital. Le problème, c’est quand cette impossibilité n’existe pas. Si on retrouve votre ADN au milieu d’une scène et que vous ne savez pas l’expliquer, c’est très compliqué. Il vous faudra alors littéralement prouver votre innocence. Pourtant, le simple fait qu’une personne mise en cause ne puisse pas expliquer comment son profil génétique est arrivé là ne veut pas nécessairement dire qu’elle est coupable. Cela donne le vertige et personnellement, cela m’effraie. Plus je connais la preuve ADN, plus elle me fait peur. Dans l’affaire corse, l’ADN a été transporté trois fois. Il y a d’abord eu un transfert primaire de la propriétaire de la villa vers le guéridon, puis un transfert secondaire, du guéridon vers les gants et enfin un transport tertiaire des gants vers les bouteilles. Je pense que cela s’est fait avec des gants car il y a un ADN unique, et non pas un mélange. Toutes ces affaires démontrent à quel point il est important de savoir discuter de la preuve génétique.
AJ : Y a-t-il des indicateurs de fiabilité de l’ADN ?
Patrice Reviron : Je me bats depuis des années pour que dans les expertises ADN figurent deux éléments qui paraissent indispensables pour discuter de la pertinence d’une trace biologique : les quantités d’ADN retrouvées et les électrophorégrammes, c’est-à-dire les données brutes des analyses d’ADN. Retrouver un profil génétique ne veut pas dire grand-chose. On a besoin de conceptualiser l’histoire de ces traces génétiques. Si de très fortes quantités de sperme sont retrouvées après un viol, cela peut vouloir dire quelque chose. Encore que : un gardien d’immeuble coupable du viol et du meurtre d’une locataire, avait récupéré des préservatifs d’un autre locataire qu’il avait mis dans le congélateur pour introduire le sperme de cet homme dans le vagin de sa victime et ainsi camoufler son crime. Heureusement, ce gardien a été identifié par d’autres indices que l’ADN et a craqué en garde à vue. Les experts, souvent, donnent beaucoup trop d’importance à l’ADN. Et on voit beaucoup d’expertises réalisées au « doigt mouillé » lors des audiences. Les experts ne sont sollicités pendant la procédure que pour répondre à la question de l’identification. À condition qu’il n’y ait pas eu d’erreur de manipulation en laboratoire, celle-ci est relativement fiable. Mais dans leurs expertises écrites, les experts ne discutent jamais, sauf demande explicite, de l’activité à l’origine du dépôt de l’ADN. Or c’est la question centrale, celle qui doit intéresser le jury d’une cour d’assises.
AJ : Qu’est-ce que l’activité de l’ADN ?
Patrice Reviron : L’activité de l’ADN, ce sont les événements qui expliquent qu’il soit arrivé sur l’objet expertisé. Le monde entier parle de ce concept, la France commence tout juste à s’y intéresser. On répand notre ADN partout autour de nous, sans forcément le savoir. Par exemple, si vous éternuez dans le métro à proximité de la barre où tout le monde se tient et que quelqu’un pose la main dessus, cette personne va repartir avec votre ADN, potentiellement en grande quantité, et pourra contaminer tout ce qu’il va toucher ensuite. Vous serez absolument incapable d’expliquer comment votre ADN s’est retrouvé dans des lieux où vous n’avez sans doute jamais été… On vient même de découvrir qu’il y a de l’ADN humain en suspension dans l’air, comme c’est le cas pour les virus. Notre ADN voyage sans que l’on en ait conscience, et peut rester très longtemps sur une surface. L’affaire Corse le montre : un profil génétique peut même être déplacé six mois après avoir été déposé sur un objet. Les conditions météo, l’humidité, la chaleur, les UV, peuvent également avoir un impact sur l’ADN. De même, que la quantité déposée au départ.
AJ : Les professionnels de la justice savent-ils discuter de cette « preuve » ?
Patrice Reviron : Pas assez. Et je pense que beaucoup de gens ne veulent pas discuter de cette question. Parfois, on s’appuie sur le simple fait qu’on ait retrouvé un profil génétique pour faire comme si c’était nécessairement celui de la personne coupable. Pour des magistrats qui ont pris l’habitude de condamner sur la base de ce seul élément, c’est difficile de renverser une habitude. Surtout si cela implique de se dire qu’on a eu tort jusque-là. Il y a donc une sorte d’inertie par rapport à la preuve génétique.
AJ : La difficulté est peut-être aussi qu’il faut des connaissances scientifiques pour pouvoir débattre…
Patrice Reviron : Non, je pense qu’il faut simplement avoir de bonnes bases de réflexion et connaître les termes du débat. Pas besoin d’être un grand scientifique pour cela. L’histoire Corse est vraiment très intéressante parce qu’elle vient démontrer, dans la vraie vie, ce que certains pensaient impossible ! Elle contredit ce que des experts assènent à longueur d’audience. Par exemple, que le transfert d’ADN d’un objet à l’autre n’est possible que dans la demi-heure qui suit le premier transfert, selon ce que l’un d’eux a pu dire devant une cour d’assises. C’est du « pipeau », mais quand c’est asséné par un expert, c’est difficile à contredire.
AJ : Il faudrait donc pouvoir remettre en question ces expertises ?
Patrice Reviron : En France, les analyses ADN sont faites par des laboratoires agréés qui ne travaillent, qu’ils soient privés ou publics, que pour la police et la justice et ne sont presque jamais challengés par des experts de laboratoires indépendants des services judiciaires. Il n’y a que quand un suspect est dans l’impossibilité d’avoir commis les faits qu’on lui reproche que l’on accepte de considérer que la preuve ADN est discutable. Ce serait à mon sens normal qu’il y ait des expertises privées. Sinon, on tombe dans le biais des experts qui se connaissent entre eux et contredisent très difficilement leurs collègues. On dit que l’ADN « parle » mais c’est faux ! C’est nous qui le faisons parler et il faut savoir comment.
Patrice Reviron : Avant d’être avocat, j’ai été infirmier puis j’ai fait une licence en biologie. J’ai ensuite choisi de me réorienter vers le droit, tout en gardant un fort intérêt pour les sciences. J’ai fait un DU de criminalistique en parallèle de mes études de droit. L’ADN m’avait toujours passionné du point de vue scientifique. En matière forensique, je lui attribuais une très forte valeur. Jusqu’au jour de 2004 où, devenu avocat depuis peu, j’ai rencontré un dossier très emblématique qui se révélera contenir deux erreurs majeures en matière d’ADN.
AJ : Quelle était cette affaire ?
Patrice Reviron : Une mère et sa fille avaient été retrouvées mortes chez elles. Les enquêteurs avaient retrouvé un profil génétique identique sur la robe de chambre de la mère et sur un fil électrique qui avait servi à attacher la fille. Ce même profil se trouvait encore sur la porte-fenêtre par laquelle s’était enfui l’auteur des faits. On considérait qu’il s’agissait forcément de l’ADN du ou d’un des auteurs. L’enquête s’est néanmoins orientée vers un suspect qui n’était pas, de façon certaine, à l’origine de ce profil génétique, sans qu’il ne soit d’ailleurs répondu à la question de savoir d’où provenait cet ADN. Le suspect avait été condamné à trente ans de réclusion. Mais avant son procès en appel, le FNAEG a identifié le profil génétique retrouvé sur les lieux du crime. Un supplément d’information a alors été ordonné. Et là, surprise : la personne identifiée à l’aide de ce profil génétique habitait à 800 kilomètres du lieu du crime et, heureusement pour elle, n’avait jamais quitté sa région de toute sa vie. Une enquête a été menée, à l’issue de laquelle il s’est avéré que les trois échantillons sur lesquels on avait retrouvé ce profil génétique avaient été contaminés au laboratoire d’analyse. C’est ce que j’appelle un cas historique : l’erreur a été démontrée de façon absolue. L’accusé condamné en première instance a finalement été condamné en appel. De façon incroyable, il s’est ensuite trouvé mis en cause à tort à cause de l’ADN pour le meurtre d’une femme tuée chez elle à Marseille. Son profil génétique avait été retrouvé sur un verre posé sur la table de nuit de la victime. Problème : au moment des faits, cet homme était en prison. Cela ne pouvait pas être lui. On a pu démontrer que deux tubes avaient été inversés au laboratoire qui travaillait au même moment sur un scellé appartenant à cet homme et sur le dossier du meurtre à Marseille. J’ai ainsi vu, dans un même dossier, deux erreurs qui étaient alors considérées comme quasiment impossibles. C’est là que j’ai vraiment commencé à m’intéresser à l’ADN comme indice.
AJ : Ces erreurs sont-elles fréquentes ?
Patrice Reviron : Ces affaires ont servi de leçon, les procédures ont été sécurisées mais il y a toujours des erreurs. Elles peuvent se produire à tous les stades, du recueil de l’indice jusqu’au travail en laboratoire et à l’interprétation des résultats d’analyse. Les erreurs de contaminations sont vite arrivées. Il suffit qu’un enquêteur manipule un objet, même sans importance, sur lequel se trouve de l’ADN d’une personne et transporte ce profil génétique avec ses gants sur un autre objet signifiant, par exemple l’arme du crime. Cela va laisser croire aux enquêteurs que la personne a touché l’arme du crime. Il faut avoir conscience du caractère fragile de l’indice ADN.
AJ : On dit pourtant que l’ADN est la reine des preuves. Depuis quand s’est-elle imposée comme telle ?
Patrice Reviron : La technique d’identification par l’ADN a été découverte en 1985 par le généticien britannique, Alec Jeffreys. Les experts travaillaient alors sur des quantités d’ADN très conséquentes et visibles : du sperme ou du sang. Au milieu des années quatre-vingt-dix, les techniques ont fortement évolué. Il est devenu possible de caractériser des profils génétiques issus d’une quantité tellement infime de matière biologique qu’elle était invisible. On a parlé alors d’ADN « de contact », mais est-ce nécessairement le cas ? Est-il nécessaire qu’un contact direct entre une personne à l’origine de l’ADN et un objet ait eu lieu ?
AJ : Racontez-nous l’affaire Lukis Anderson, aux États-Unis…
Patrice Reviron : C’est une affaire réelle qui montre à quel point la preuve ADN est fragile. En 2012, Lukis Anderson a été mis en cause en Californie pour avoir participé à un « home jacking », un cambriolage très violent au cours duquel le propriétaire de la villa avait été tué. Quand une victime se défend, on peut parfois retrouver l’ADN de son agresseur sous ses ongles. Or l’ADN de Lukis Anderson a été retrouvé sous les ongles du propriétaire de la villa. Anderson est alors répertorié dans la base de données génétique locale, ce qui permet de l’identifier : il est placé en détention. Une avocate commise d’office est désignée. Elle enquête et découvre que Lukis Anderson, au moment des faits, était dans le coma à l’hôpital, surveillé toutes les 20 minutes. Cela ne pouvait pas être lui…
AJ : Comment son ADN était-il arrivé sous les ongles de la victime ?
Patrice Reviron : L’équipe paramédicale qui a récupéré Lukis Anderson le matin est ensuite intervenue sur la scène de crime. Dans les deux cas elle a utilisé un oxymètre de pouls, un petit objet que l’on met au bout du doigt pour évaluer les pulsations cardiaques et l’oxygénation du sang. C’est l’oxymètre qui a transféré, trois heures plus tard, l’ADN de Lukis Anderson sous les ongles de la victime, où il s’est mélangé avec celui de cet homme et de son épouse.
AJ : La France a-t-elle connu des cas similaires ?
Patrice Reviron : Oui. En Corse, lors d’une « nuit bleue », des autonomistes ont fait sauter des villas de continentaux. Ils avaient installé des bouteilles de gaz dans plusieurs villas vides. Dans une des maisons, trois bouteilles de gaz n’ont pas explosé. On a recherché des profils génétiques sur ces bouteilles de gaz et on a effectivement retrouvé un ADN sur la collerette à la base de chacune des trois bouteilles. On a caractérisé le même ADN, dans la chambre où elles se trouvaient, sur le guéridon et la lampe de chevet posée sur un lit lui-même poussé par les auteurs pour faire de la place. Tous ces objets avaient été manipulés par les auteurs pour installer les explosifs. Les enquêteurs ont constaté qu’il s’agissait d’un profil génétique féminin, chose inhabituelle pour des attentats en Corse. Surtout, ils ont très vite découvert qu’il s’agissait de l’ADN de la propriétaire des lieux, âgée de 78 ans, qui n’avait pas mis les pieds dans sa résidence secondaire depuis six mois. L’auteur des faits avait manipulé le guéridon et la lampe avec des gants et déplacé ainsi l’ADN de la propriétaire sur les trois bouteilles de gaz. Cette hypothèse était incontournable dès lors qu’il était avéré que cette dame n’avait pas mis les pieds en Corse depuis plus de six mois. Si elle avait été présente la veille dans sa maison, on aurait pu croire qu’elle avait simulé un attentat pour obtenir de l’argent de son assurance, par exemple.
AJ : Que montrent ces situations ?
Patrice Reviron : Déjà, que l’indice ADN est fragile. Mais aussi qu’on ne se pose des questions à son sujet que s’il y a une impossibilité manifeste que le profil génétique retrouvé corresponde à celui de l’auteur. Par exemple, quand le suspect est emprisonné ou à l’hôpital. Le problème, c’est quand cette impossibilité n’existe pas. Si on retrouve votre ADN au milieu d’une scène et que vous ne savez pas l’expliquer, c’est très compliqué. Il vous faudra alors littéralement prouver votre innocence. Pourtant, le simple fait qu’une personne mise en cause ne puisse pas expliquer comment son profil génétique est arrivé là ne veut pas nécessairement dire qu’elle est coupable. Cela donne le vertige et personnellement, cela m’effraie. Plus je connais la preuve ADN, plus elle me fait peur. Dans l’affaire corse, l’ADN a été transporté trois fois. Il y a d’abord eu un transfert primaire de la propriétaire de la villa vers le guéridon, puis un transfert secondaire, du guéridon vers les gants et enfin un transport tertiaire des gants vers les bouteilles. Je pense que cela s’est fait avec des gants car il y a un ADN unique, et non pas un mélange. Toutes ces affaires démontrent à quel point il est important de savoir discuter de la preuve génétique.
AJ : Y a-t-il des indicateurs de fiabilité de l’ADN ?
Patrice Reviron : Je me bats depuis des années pour que dans les expertises ADN figurent deux éléments qui paraissent indispensables pour discuter de la pertinence d’une trace biologique : les quantités d’ADN retrouvées et les électrophorégrammes, c’est-à-dire les données brutes des analyses d’ADN. Retrouver un profil génétique ne veut pas dire grand-chose. On a besoin de conceptualiser l’histoire de ces traces génétiques. Si de très fortes quantités de sperme sont retrouvées après un viol, cela peut vouloir dire quelque chose. Encore que : un gardien d’immeuble coupable du viol et du meurtre d’une locataire, avait récupéré des préservatifs d’un autre locataire qu’il avait mis dans le congélateur pour introduire le sperme de cet homme dans le vagin de sa victime et ainsi camoufler son crime. Heureusement, ce gardien a été identifié par d’autres indices que l’ADN et a craqué en garde à vue. Les experts, souvent, donnent beaucoup trop d’importance à l’ADN. Et on voit beaucoup d’expertises réalisées au « doigt mouillé » lors des audiences. Les experts ne sont sollicités pendant la procédure que pour répondre à la question de l’identification. À condition qu’il n’y ait pas eu d’erreur de manipulation en laboratoire, celle-ci est relativement fiable. Mais dans leurs expertises écrites, les experts ne discutent jamais, sauf demande explicite, de l’activité à l’origine du dépôt de l’ADN. Or c’est la question centrale, celle qui doit intéresser le jury d’une cour d’assises.
AJ : Qu’est-ce que l’activité de l’ADN ?
Patrice Reviron : L’activité de l’ADN, ce sont les événements qui expliquent qu’il soit arrivé sur l’objet expertisé. Le monde entier parle de ce concept, la France commence tout juste à s’y intéresser. On répand notre ADN partout autour de nous, sans forcément le savoir. Par exemple, si vous éternuez dans le métro à proximité de la barre où tout le monde se tient et que quelqu’un pose la main dessus, cette personne va repartir avec votre ADN, potentiellement en grande quantité, et pourra contaminer tout ce qu’il va toucher ensuite. Vous serez absolument incapable d’expliquer comment votre ADN s’est retrouvé dans des lieux où vous n’avez sans doute jamais été… On vient même de découvrir qu’il y a de l’ADN humain en suspension dans l’air, comme c’est le cas pour les virus. Notre ADN voyage sans que l’on en ait conscience, et peut rester très longtemps sur une surface. L’affaire Corse le montre : un profil génétique peut même être déplacé six mois après avoir été déposé sur un objet. Les conditions météo, l’humidité, la chaleur, les UV, peuvent également avoir un impact sur l’ADN. De même, que la quantité déposée au départ.
AJ : Les professionnels de la justice savent-ils discuter de cette « preuve » ?
Patrice Reviron : Pas assez. Et je pense que beaucoup de gens ne veulent pas discuter de cette question. Parfois, on s’appuie sur le simple fait qu’on ait retrouvé un profil génétique pour faire comme si c’était nécessairement celui de la personne coupable. Pour des magistrats qui ont pris l’habitude de condamner sur la base de ce seul élément, c’est difficile de renverser une habitude. Surtout si cela implique de se dire qu’on a eu tort jusque-là. Il y a donc une sorte d’inertie par rapport à la preuve génétique.
AJ : La difficulté est peut-être aussi qu’il faut des connaissances scientifiques pour pouvoir débattre…
Patrice Reviron : Non, je pense qu’il faut simplement avoir de bonnes bases de réflexion et connaître les termes du débat. Pas besoin d’être un grand scientifique pour cela. L’histoire Corse est vraiment très intéressante parce qu’elle vient démontrer, dans la vraie vie, ce que certains pensaient impossible ! Elle contredit ce que des experts assènent à longueur d’audience. Par exemple, que le transfert d’ADN d’un objet à l’autre n’est possible que dans la demi-heure qui suit le premier transfert, selon ce que l’un d’eux a pu dire devant une cour d’assises. C’est du « pipeau », mais quand c’est asséné par un expert, c’est difficile à contredire.
AJ : Il faudrait donc pouvoir remettre en question ces expertises ?
Patrice Reviron : En France, les analyses ADN sont faites par des laboratoires agréés qui ne travaillent, qu’ils soient privés ou publics, que pour la police et la justice et ne sont presque jamais challengés par des experts de laboratoires indépendants des services judiciaires. Il n’y a que quand un suspect est dans l’impossibilité d’avoir commis les faits qu’on lui reproche que l’on accepte de considérer que la preuve ADN est discutable. Ce serait à mon sens normal qu’il y ait des expertises privées. Sinon, on tombe dans le biais des experts qui se connaissent entre eux et contredisent très difficilement leurs collègues. On dit que l’ADN « parle » mais c’est faux ! C’est nous qui le faisons parler et il faut savoir comment.



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 













 L’ADN est-il vraiment la reine des preuves ?
L’ADN est-il vraiment la reine des preuves ?